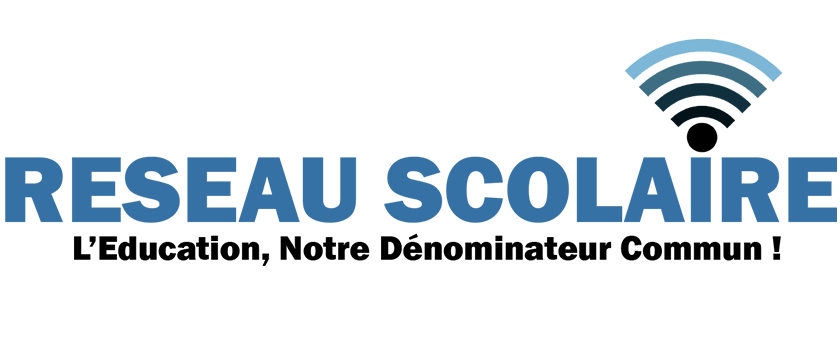- COURS
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES(SSP)
INTRODUCTION
L’OMS lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires réunie à Alma Ata en 1978 a souligné la nécessité d’une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé et du développement ainsi que de la communauté internationale pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde.
I – DEFINITION
Pour la Conférence de Alma-Ata en Genève en 1978, les Soins de Santé Primaires sont: «des soins essentiels reposant sur des méthodes et techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendu universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays peuvent supporter à tous les stades de leur développement, dans un esprit d ’auto-responsabilité et d ’autodétermination ».
Ils sont partie intégrante du processus de développement socio économique de la Communauté et représentent le premier contact des individus avec le système national de santé.
II – HISTORIQUE
Avant 1977, l’approche était curative, et le concept de Santé / Maladie a entrainé le développement des connaissances techniques;
-L’Hôpital et ses laboratoires étaient les centres d’intérêts privilégiés pour la recherche et le travail médical; d’où les raisons lucratives et la promotion des médicaments et des techniques pour la Médecine Moderne;
– Avec la Médecine Moderne, le traitement était onéreux avec l’ exclusion des pauvres et un accès pour une minorité de privilégiés (1/5 de la population
En 1977, à Genève lors de la Résolution 30-34 de la 30ème Assemblée Mondiale, l’Organisation Mondiale de la santé déclarait:
« Le principal objectif social des Gouvernements et de l ’OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d ’ici l ’an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ».
Après, plusieurs réunions préparatoires se sont tenues :
- Réunion du comité d’experts sur les Soins de Santé Primaires dans la région africaine à Brazzaville(1977);
- 4ème Réunion extraordinaire des Ministres des pays membres de l ’Organisation Panafricaine de la Santé à Washington(Sept.77);
- Réunion mixte FISE/OMS des pays de la Région de la Méditerranée Orientale à Alexandrie (Oct.77);
- Conférence sur les Soins de santé primaires dans la région Pacifique Occidentale, à Manille (Nov. 77);
- Réunion mixte FISE/OMS sur les SSP dans la Région de l ’Asie du Sud-est à New-Delhi(Nov.77);
- Conférence sur les SSP dans les Pays industrialisés à New York, (Déc.77)
En 1978, s’est tenue du 06 au 12 Septembre à Alma Ata (République . De Kazakhie) la conférence internationale sur les Soins de Santé Primaire les objectifs étaient:
- Promouvoir la notion de SSP dans tous les Pays, développés comme en développement;
- Échanger des données d’expériences et des informations relatives au développement des SSP;
- Évaluer la situation mondiale actuelle dans le domaine de la santé et des SSP;
- Définir les Principes qui doivent régir les SSP ainsi que les moyens opérationnels;
- Définir le rôle qui incombe aux gouvernements et Organisations nationales et internationales dans le cadre de la coopération technique et l ’appui à apporter aux SSP;
- Formuler des recommandations pour le développement des SSP.
III – LES PRINCIPES DE BASE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
- LE PRINCIPE DE L’EQUITE :
c’est le principe essentiel des SSP qui « sont le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la communauté avec le Système national de santé ».
L’’idéal de justice dans ce domaine veut que les services soit:
– accessibles géographiquement et socioculturelle ment,
– acceptables au plan technologique et technique, culturel, social et biologique,
– abordables au plan financier.
- LE PRINCIPE DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE :
« Les SSP exigent la participation des bénéficiaires à tous les stades du processus de résolution des problèmes depuis leur identification jusqu’à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions visant à les résoudre. Cette participation doit se faire dans un esprit d’auto-responsabilité, d’auto-détermination et d’indépendance totale ».
Pour cela, il faut un transfert des connaissances et compétences nécessaires aux individus, familles et communautés pour leur auto-prise en charge.
- LE PRINCIPE DE LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE :
Les Soins doivent reposer sur des solutions simples, pratiques, orientées vers la résolution des problèmes du grand nombre, la majorité.
Exemple l’utilisation du périmètre brachial pour le dépistage de la malnutrition et la RVO pour le traitement de la diarrhée.
- LE PRINCIPE DE MULTISECTORIALITE ET PLURIDISCIPLINARITE :
Ce principe découle du fait que la santé dépendant de plusieurs facteurs: socioculturels, comportementaux, environnementaux, économiques et biologiques, essentiellement.
« Les activités du secteur sanitaire doivent s’appuyer sur une technologie appropriée, et coordonnée au niveau national, intermédiaire, et local ou communautaire avec celles des autres secteurs économiques et sociaux, notamment ceux de l ’éducation, l ’agriculture, l ’élevage, l ’approvisionnement en eau potable, l ’habitat, les travaux publics, les communications et de la production industrielle ». (rapport FISE/OMS, Alma ata 1978).
- LE PRINCIPE DE LA PREVENTION :
Ce principe guide et justifie en majeure partie les autres. Il est contenu dans les objectifs de la santé pour tous d’ici l ’an 2000, tout comme dans la définition des SSP. Il comprend la prévention primaire des affections et des lésions courantes.
« L ’accès universel des individus, des familles et de la communauté toute entière à des soins de santé de qualité, sans distinction aucune, en privilégiant les plus pauvres au sein de la communauté suppose que la prévention soit mise en avant ». Rapport FISE/OMS
IV- LES PRINCIPALES COMPOSANTES DES SSP
- l’éducation pour la Santé:
- la Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles;
- l’approvisionnement en quantité suffisante en eau potable et assainissement du milieu;
- la promotion de la santé de la mère et de l’enfant y compris la Planification Familiale(PF);
- la vaccination contre les maladies infectieuses dans le cadre du Programme Elargie de Vaccinale(PEV);
- la prévention et le contrôle des endémies locales dont le paludisme;
- la prise en charge des affections et des lésions courantes;
- l’approvisionnement (fourniture) en médicaments essentiels.
- La promotion de la pharmacopée traditionnelle
V- LES STRATEGIES D’APPLICATION
En 1979, l ’Assemblée Mondiale de la Santé a lancé la stratégie mondiale de la santé pour tous en invitant les états membres à formuler individuellement et collectivement des stratégies régionales et mondiales .C’est ainsi que 9 axes stratégiques avaient été identifiés :
- Le développement des infrastructures appropriées pour la totalité de la population;
- L ’indication des mesures à mettre en œuvre par les individus et les familles dans leur foyer, par les collectivités, par les services de santé au niveau primaire et aux échelons d’appui, et par d’autres secteurs y compris le choix des technologies adaptées au contexte;
- La précision de l’action internationale à entreprendre pour épauler l ’action nationale: échange d ’informations, promotion de la recherche et du développement, soutien technique, formation, coordination au sein du secteur de la santé et entre celui-ci et les autres éléments essentiels des soins de santé primaire dans les pays,
- Le renforcement du Ministère de la Santé comme point focal de la stratégie et l’obtention de l’engagement politique des décideurs au niveau le plus élevé;
- La réorganisation du système national en précisant le rôle, l’organisation et le mode de fonctionnement pour chaque niveau;
- La mise au point d’un processus gestionnaire pour le développement sanitaire national qui intègre les aspects de la planification et gestion des ressources et des activités;
- La création et la mobilisation de toutes les ressources possibles: humaines, matérielles et financières;
- Le développement de la coopération inter pays pour assurer un soutien mutuel dans les divers domaines de la stratégie;
- Le développement d’un processus de surveillance continue des progrès réalisés et d’évaluation périodique des résultats enregistrés.
VI-LA MISE EN ŒUVRE
Pour appliquer les stratégies de la santé pour tous d’ici l’an 2000 dans la sous-région Afrique, l ’Assemblée Régionale s’est réunie à Lusaka en Zambie en 1985 et a défini et adopté le scénario de développement sanitaire à 3 phases suivant dont trois niveaux ont été identifiés pour permettre une meilleure gestion du système de santé:
– le niveau périphérique ou opérationnel
– le niveau intermédiaire ou régional
– et le niveau central».
CONCLUSION
Les Soins de Santé Primaires sont une véritable révolution dans l’approche de résolution des problèmes de santé;
Sa stratégie reste toujours valable et demeure la base du développement sanitaire national et international.
LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE DU SENEGAL
INTRODUCTION
Le Système national de santé est un élément de La politique de Santé définie par le Chef de l’Etat et mise en œuvre par le Ministère de la Santé.
La politique nationale de santé a connu une évolution marquée par 5 événements majeurs :
En 1972, avec le début de la réforme de l’Administration Territoriale et Locale (loi 72-02 du 1er février 1972) s’appuyant sur le tri type = DECONCENTRATION- DECENTRALISATION-PARTICIPATION.
- En Septembre 1978, Réunion à Alma Ata sur les SSP en vue de la réalisation de l’objectif Santé pour Tous en l’an 2000. Grâce à cette réunion, l’expérience du Sénégal en matière de SSP s’enrichit avec notamment 4 concepts :
- Décentralisation des services de santé,
- Priorité à la médecine préventive,
- Vision multisectorielle de la santé,
- Pleine participation des populations à l’effort de santé.
- 1980 : Tournant décisif avec l’extension de la participation financière des populations à l’effort de santé au niveau de tous les centres et postes de santé du pays à partir d’un modèle inspiré par l’expérience de Pikine.
- En Juin de la même année 1980, tenue à Rufisque de la première conférence atelier sur les Soins de Santé Primaires( SSP) au Sénégal.
- En Octobre 1989, Déclaration de la Politique Nationale de Santé.
- Un long processus de réflexion, engagé en 1995, a abouti au Plan Nationale de Développement Intégré de la Santé (mis en place en 1998 pour une durée de 10 ans. De ce plan est extrait le Programme de Développement Intégré de la Santé (PDIS) qui a couvert la période de 1998 à 2002.
Il visait à améliorer l’accès aux services, la santé génésique, les capacités institutionnelles du secteur, la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies endémiques, la qualité de vie des groupes défavorisés.
En 1998 une réforme du système hospitalier a été opérée notamment par la création des Etablissements Publics de Santé (EPS). Bien que ce nouveau statut offre aux hôpitaux une plus grande autonomie de gestion, l’Etat garde un certain droit de regard sur leurs activités par l’attribution de subventions de fonctionnement et d’investissement.
Il faut noter que, dans son application, cette réforme hospitalière connaît quelques problèmes et des correctifs devront être apportés pour la rendre plus fonctionnelle et plus réaliste.
I- Système public de santé
Il est constitué par l’ensemble des services administratifs et structures de santé dépendant de l’autorité publique.
Le Ministère de la Santé a pour mission d’assurer la mise en œuvre et l’application de la politique du Gouvernement en matière de santé :
Le decret N°79-416 du 12.05.1979 réorganise le Ministère de la Santé qui comprend :
1-1- L’ECHELON CENTRAL composé :
-du Cabinet du Ministre : qui comprend :
Un Secrétaire général
Un Directeur de cabinet
Un Chef de cabinet
Un Attaché de cabinet
Des Conseillers techniques
-de l’Inspection de la Santé
-les Directions de la Santé (et Services rattachés) qui sont :
La Direction de la santé(DS)
La Direction de la Prévention médicale(DPM)
La Direction des Ressources Humaines (DRH)
La Direction des Etablissements de Santé (DES)
La Direction de la Pharmacie et du Laboratoire (DPL)
La Direction des Infrastructures, de l’Equipements et de la Maintenance (DIEM)
La Direction de l’Administration Général et de l’Equipement (DAGE)
Le Service National de l’Hygiène (SNH)
-Direction Générale de l’Action Sociale
Le niveau central fournit les directives, appui et évalue les résultats à tous les niveaux.
2-2- LES REGIONS MEDICALES
Le Sénégal compte 14 régions médicales. La région médicale, dont l’aire d’intervention
correspond à celle de la région administrative, assure la coordination, la supervision,
l’inspection et le contrôle des structures sanitaires publiques et privées de la région. Elle
organise la collaboration technique entre toutes les structures régionales de santé et les assiste
dans leur tâche d’administration, de gestion et de planification. Toutefois, les Régions
Médicales jouent difficilement ce rôle en raison de l’insuffisance des capacités et des
ressources humaines et logistiques.
1-3- LES DISTRICTS SANITAIRES
Le Sénégal compte 76 districts sanitaires qui constituent une subdivision sanitaire proche des
populations. Le district est l’unité opérationnelle la plus périphérique de la pyramide sanitaire.
Il s’y applique la médecine dans son aspect quadridimensionnel : curatif, préventif, social et
éducatif. Le district est constitué d’un ou de plusieurs centres de santé et englobe un réseau de
postes de santé eux-mêmes supervisant les cases de santé et les maternités rurales.
1-4- LES INFRASTRUCTURES RELEVANT DU MINISTERE DE LA SANTE :
Le système de santé se présente sur la forme d’une pyramide à trois niveaux :
- LE NIVEAU PERIPHERIQUE OU OPERATIONNEL avec :
- le niveau local ou communautaire: qui constitue la base avec une multitude de Postes de santé, un nombre considérable de cases de santé et de maternités rurales.
A ce niveau communautaire s’effectuent les soins primaires. Le PS est l’infrastructure dite « cheville ouvrière» pour l’application des SSP.
- Le niveau départemental: c’est le siège du District Sanitaire où existe au minimum 1 centre de santé et un réseau de PS implantés dans les communes, les chefs-lieux de communautés rurales ou les villages relativement peuplés.
On dénombre actuellement dans le pays prés de 76 Districts sanitaires.
Le Centre de santé est le niveau privilégié de gestion de la politique de santé, on en dénombre plus de 70 : ruraux et urbains.
C’est aussi le niveau d’intégration des différents types de soins.
Le district sanitaire est le niveau opérationnel du système de santé.
- LE NIVEAU INTERMEDIAIRE :
ou niveau régional, siège de la région médicale et où sont effectués les soins tertiaires.
Le niveau intermédiaire est divisé en régions médicales avec les hôpitaux régionaux et les hôpitaux départementaux.
- LE NIVEAU CENTRAL
Au sommet de la Pyramide se trouve les Hôpitaux nationaux ( Centres Hospitaliers Universitaires : CHU).
Tableau d’équivalence entre système de santé et niveau administratif
| SYSTEME DE SANTE | NIVEAU ADMINISTRATIF |
| Hôpitaux Nationaux(C.H.U) | National |
| Hôpitaux régionaux(C.H.R) | Région |
| Centres de Santé (C.S) | Département |
| Postes de santé(P.S) | Arrondissement |
| Cases de santé et maternités rurales (C.S/MR) | village |
1-5- LES INFRASTRUCTURES SANITAIRES RELEVANT DES AUTRES DEPARTEMENTS.
Il s’agit essentiellement des établissements sanitaires rattachés aux ministères suivants :
- Ministère de l’Education Nationale
- Ministère des Forces Armées
- Ministère de l’Intérieur
- Ministère de la Fonction Publique
- Ministère de la Justice
- Ministère de l’Economie et des Finances.
II- LE SYSTEME PRIVE DE SANTE
Est largement concentré à la capitale ; cohabite avec le système public et se compose :
- du privé lucratif
- du privé non lucratif
- de la Médecine traditionnelle
2-1- LE PRIVE LUCRATIF
Il comprend :
- Les Infirmeries
- Les Cabinets médicaux et dentaires : prés d’un millier
- Les cliniques : plus d’une soixantaine
- Les officines : prés d’un millier
2-2 – LE PRIVE NON LUCRATIF
Il comprend :
- Les postes de santé privés catholiques : plus d’une centaine
- Les infirmeries et cabinets d’entreprise : plus d’une cinquantaine
- Un hôpital (St Jean de Dieu de Thiès)
- Le dispensaire ophtalmologique de Bopp.
2-3- LA MEDECINE TRADITIONNELLE
C’est un système informel et non reconnu par le code de déontologie médicale.
La médecine traditionnelle reste pour la grande majorité des sénégalais le premier recours en matière de santé primaire (60%de la population).
Les Autorités veulent réglementer ce type de médecine mais le handicap demeure une rationalisation des pratiques et une connaissance des plantes médicinales réellement efficaces et non dangereuses.
Compte tenu de son importance, des efforts sont en train d’être consentis pour son intégration dans le système de santé.
REMARQUES :
Les efforts investis dans le secteur de la santé avec la construction de nouveaux établissements et la formation de nombreux agents étaient nécessaires mais sont encore insuffisants compte-tenu de la croissance démographique élevée du Sénégal.
Le Sénégal manque surtout de spécialistes. Les Etablissements hospitaliers sont d’équipement et de valeur très inégaux. Plusieurs cliniques privées ont une hôtellerie satisfaisante. La qualité des soins dispensés est très inégale.
L’assurance maladie est encore fragmentaire et ne couvre que 15 % de la population dont la moitié (700 000) sont les familles des salariés du Privé qui sont couverts par une assurance maladie obligatoire gérée par les Institutions de prévoyance maladie(IPRESS, CAISSE DE SECURITE SOCIALE) .Le mouvement mutualiste est dynamique et constitue un axe fort de la politique nationale de la santé avec la Couverture Maladie Universelle(CMU)mais les résultats restent timides.
La médecine pré-hospitalière est représentée sur le plan public par les ambulances des sapeurs pompiers qui ne sont pas médicalisées.
Sur le plan privé, deux sociétés se font distinguer :
- SOS Médecins = structure médicale très professionnelle, assurant les visites à domicile et le transport médicalisé des malades et des blessés, grâce à 6 ambulances médicalisées et une équipe de 30 médecins. Elle assure également les rapatriements sanitaires pour le compte des sociétés d’assistance.
- SUMA : (Société d’Urgence Médicale et d’Assistance) est la société concurrente qui possède également un parc d’ambulance dont 2 médicalisées. La SUMA prend également en charge les évacuations de et vers les pays de la sous-région (Mali), mais aussi à l’international.
CONCLUSION :
Le Sénégal consent des efforts appréciables dans le Système National de Santé et la politique de santé en général avec la construction et l’équipement d’infrastructures, le recrutement de personnel de santé, la Couverture Maladie Universelle et la politique de gratuité surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, chez les femmes enceintes avec la césarienne et l’introduction de nouveaux vaccins.
Mais des difficultés majeurs existent en termes de déficit d’infrastructures, de ressources humaines, d’équipements dont l’existent même est souvent vétuste.
LA POLITIQUE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS : INITIATIVE DE BAMAKO (I.B)
INTRODUCTION
L’initiative de Bamako correspond à une réforme de la gestion des systèmes de santé adoptée à la suite d’une réunion des ministres africains de la santé tenue à Bamako au Mali, elle est mise en œuvre dans plusieurs pays en voie de développement, confrontés à des situations économiques difficiles, à partir de la fin des années 1980.
1 – DEFINITION
L’initiative de Bamako est une résolution prise par le comité Régional de l’OMS pour l’Afrique par la résolution ARF/RC37/R6 à Bamako en septembre 1987. Elle demandait à l’UNICEF et à l’OMS de contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des SSP au niveau des districts en accordant la priorité aux femmes et aux enfants. L’I.B permet de mettre en place un système de financement par les utilisateurs et un système de recouvrement des coûts par le renouvellement des stocks.
2 – BUT ET OBJECTIFS
l’I.B vise à mobiliser les ressources nécessaires au renforcement et à l’élargissement du réseau des Soins de Santé Primaires(SSP) à assise communautaire au niveau du district grâce à un recouvrement des coûts des médicaments et fournitures essentiels par les utilisateurs des services des formations sanitaires.
3 – LE MEDICAMENT ESSENTIEL ( M.E)
C’est un médicament qui a une valeur thérapeutique significative, un niveau acceptable de sécurité et une qualité suffisante pour son prix. Le ME est un médicament qui répond aux besoins courant d’une zone de responsabilité donnée.
4 – HISTOTRIQUE DE L’I.B
Toutes les expériences dans le domaine des SSP du début des années 80 étaient in opérationnelles en Afrique. Les besoins en santé étaient en croissance permanente et les services rencontrent d’énormes difficultés pour y faire face.
Les Ministres de la santé réunis à Bamako en septembre 1987 dans le cadre de l’assemblée générale de l’OMS lancent un grand défi : L’Initiative de Bamako (I.B)
La finalité est la réorganisation du système de santé et des activités de SMI en assurant au plutôt et de manière permanente la protection des mères et des enfants
En 1975, deux expériences ont eu lieu dans l’ex région du Sine – Saloum :
1975-1978: Instauration de soins de santé de base avec création de pharmacies villageoises (le gérant secouriste travaillait avec un stock initial et un système de recouvrement des coûts des M.E)
Acquis : décentralisation des soins et initiation au recouvrement.
Difficultés : Le rayon d’action était limité au siège de la CR, le comité de santé non fonctionnel , importants stocks de M.E périmés et un manque d’adhésion des populations d’où la mise en place du Projet Santé Rurale USAID(1978-1989).
L’objectif est de rendre accessible les M.E (liste) aux populations avec mise en place d’un système de recouvrement des coûts et un système d’approvisionnement mais aussi de décentraliser les soins par la mise en place d’un réseau dense de cases de santé.
Pour les acquis, on peut citer :
- Système de recouvrement à la portée des populations ;
- Système d’approvisionnement assez performant ;
- Sélection des M.E avec une liste bien établie.
Des difficultés ont été notées :
- Mauvaise gestion ( manque de motivation) ;
- Techniciens de santé non responsabilisés ;
- Ruptures de M.E ( non disponibilité des finances) ;
- Les structures ne bénéficiaient pas des avantages du système.
5 – IMPORTANCE DEL’IB DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE
L’IB était centrée sur les médicaments et l’objectif est l’accès à toute la population aux produits pharmaceutiques essentiels les plus efficaces, les moins dangereux, d’une qualité démontrée et à un prix raisonnable.
Mais aussi la promotion d’un système de santé autosuffisant, soutenu par la communauté, qui assure des soins de santé globaux, intégrés, continus de meilleure qualité, accessibles à tous particulièrement aux pauvres ( indigents et cas sociaux)
Cependant, on a noté quelques problèmes à savoir :
une rupture de ME dans les structures sanitaires lors de l’élaboration des PDDS et PRDS, le budget alloué par l’état pour achat de P.E et M.E était insuffisant, des lourdeurs administratives et des ruptures stocks au niveau de la PNA ,des PR et une mortalité maternelle et infantile élevée.
L’approvisionnement en M.E est une des 8 composantes des SSP, dans le cadre de la résolution des problèmes constatés, une prévision a été faite lors de l’élaboration des PDDS et PRDS avec une première dotation en M.E avec système de recouvrement des coûts pour renouveler périodiquement les stocks avec un fond de roulement.
Cet objectif a été réalisé en 1992 avec le<Don Suisse> chaque district ayant reçu un lot de M.E destiné aux C.S et P.S: 600 millions de francs CFA en M.E mis en place dans les 10 anciennes régions du Sénégal par le Gouvernement, avec la formation des: MCR-MCD-ECR-ECD-ICP grâce à l’appui de l’UNICEF pour les districts de Podor, Matam, Kolda.
6 – STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DE L’IB AU SENEGAL
Des critères à remplir ont été définis par le ministère de la santé avant le démarrage de l’I.B au niveau des formations sanitaires :
- La réorganisation et la redynamisation du comité de santé ( comité de santé fonctionnel) ;
- La pérennisation du système de recouvrement ;
- . la formation des ICP, gestionnaires de dépôt et des membres du comité de santé sur l’I.B ;
- L’implantation d’une centrale d’achat ;
- La disponibilité des M.E pour un stock de démarrage ;
- L’identification de la population cible pour chaque type d’activité ;
- La détermination de la zone de responsabilité de la formation sanitaire avec carte ;
- La mise en place d’un système de Supervision,Contrôle et
7 – LES OUTILS DE GESTION DE L’IB
- Le carnet de commande/livraison ;
- La fiche de stock ;
- Le registre journalier de distribution des médicaments et vaccins;
- Le registre de sortie des médicaments par malade ;
- Le cahier de versement des vendeurs de tickets et médicaments ;
- Le registre mensuel des recettes et dépenses ;
- Le livret d’épargne ;
- La fiche inventaire des médicaments ;
- Le cahier de gestion des recettes et des dépenses ;
- Les carnets de tickets.
CONCLUSION
L’avènement de l’I.B a suscité beaucoup d’espoir dans la voie de l’accélération de la mise en œuvre des SSP pour l’instauration de la santé pour tous.
La réussite de l‘application de l’I.B repose sur l’engagement des équipes responsables de la gestion du système de santé au niveau des districts en particulier les ICP et une participation responsable des populations bénéficiaires.
- EXAMEN DE CERTIFICATION AU DIPLOME D’ASSISTANT INFIRMIER D’ETAT
Clé de correction du sujet de santé communautaire première session
- Déterminer le nombre de consultants et de consultations pour la période
- Le nombre de consultants (1 pt)
Consultants= nombre total de cas
AN : consultants = 62+58+142+58+16+ 32 = 368 cas
- Le nombre de consultations (1pt)
Consultation = nombre de cas + ce qui sont revenus
AN : Consultation =368 + 2 = 388 cas
- Calculez les taux globaux de morbidité et de mortalité
- Taux global de morbidité (2pts)
= 1.53%
- Taux global de mortalité (2pts)
= 0,045%
3) calculez le taux de morbidité spécifique, le taux de mortalité proportionnel et le taux de létalité de l’affection la plus fréquente
- Taux de morbidité de l’affection la plus fréquente (maladies diarrhéiques)(2pts)
= 0,059%
- Taux de mortalité proportionnelle de la diarrhée (2pts)
= 81.81%
- Taux de létalité (2pts)
= 6.33%
Respecter les critères de formulation d’un :
4.OBJECTIF GENERAL(2pts)
En rapport avec le problème : Nature de la situation désirée
Critère de succès, Cible, Localité Echéance
5.OBJECTIFS SPECIFIQUES(2×2= 4pts)
En rapport avec l’objectif général : Nature de la situation désirée
Critère de succès, Cible, Localité Echéance
6.ACTIVITES (0,5X4= (2pts)
En rapport avec l’objectif spécifique : Le verbe, Le thème, La périodicité et le nombre
GRILLE DE CORRECTION SANTE COMMUNAUTAIRE APO AI PREMIERE SESSION 2018
| ELEMENTS DE REPONSES | POND | NUMEROS ANONYMES | |||||||||||||||
| 1. DETERMINER LE NOMBRE DE CONSULTANTS ET DE CONSULTATIONS POUR LA PERIODE 2 POINTS | |||||||||||||||||
| Nombre de consultants = 368 cas | 1 | ||||||||||||||||
| Nombre de consultations = 388 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. CALCULEZ LES TAUX GLOBAUX DE MORBIDITE ET DE MORTALITE 4 POINTS | |||||||||||||||||
| Taux global de morbidité =1.53% | 2 | ||||||||||||||||
| Taux global de mortalité= 0.045 % | 2 | ||||||||||||||||
| 3. CALCULEZ LE TAUX DE MORBIDITE SPECIFIQUE, LE TAUX DE MORTALITE PROPORTIONNEL ET LE TAUX DE LETALITE DE L’AFFECTION LA PLUS FREQUENTE 6 POINTS | |||||||||||||||||
| Taux de morbidité de l’affection la plus fréquente (maladies diarrhéiques) = 0.059 % (2pts) |
2 |
||||||||||||||||
| Taux de mortalité proportionnelle de la diarrhée = 81.81 %(2pts) | 2 | ||||||||||||||||
| Taux de létalité = 6.33 % (2pts) | 2 | ||||||||||||||||
| 4. FORMULER UN OBJECTIF GENERAL, DEUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 8 POINTS | |||||||||||||||||
| Objectif général | viser la résolution avec du problème et respecte les critères de formulation | 02 | |||||||||||||||
| OS1+ OS2 | concourir à l’atteinte de l’objectif général et respecter les critères de formulation (2*2) | 04 | |||||||||||||||
| Activités | concourir à l’atteinte de spécifique et respecter les critères de formulation (0.5*4) | 02 | |||||||||||||||
|
TOTAL |
20 | ||||||||||||||||
- EXAMEN DE CERTIFICATION AU DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER
EPREUVES DE SANTE COMMUNAUTAIRE DUREE : 2 HEURES
Suite à votre séjour dans la communauté rurale de MELAFI qui ne dispose que d’un (1) poste de Santé l’analyse des données collectées vous a permis de ressortir les informations suivantes :
- Un taux de réalisation du dépistage du VIH/SIDA inférieur à 10 % chez les jeunes, pour une norme de 80%
- Un taux de réalisation du dépistage du VIH/SIDA inférieur à 30% chez les femmes enceintes reçues en consultation prénatale, le (résultat attendu est de 95 %) ;
- Une fréquence élevée des accouchements non assistés ; en fait 68% des accouchements enregistrés ont eu lieu hors des structures de santé ;
- Un taux de 79% d’abandon des traitements par les malades dépités tuberculose ; cinq (5) mois seulement après les avoir entamés ;
- Une recrudescence des cas de paludisme (58% des malades reçus à la consultation primaire curative), malgré une tendance générale à la baisse, au niveau national.
Travail à faire :
- Parmi ces faits de santé cités plus haut, sélectionner trois (3) problèmes prioritaires en de basant sur des critères objectifs (5 pts)
- Citer trois (3) causes probables pour chaque problème sélectionné (7pts)
- Proposer un plan d’action pour la résolution de deux (2) problèmes parmi les trois (3) sélectionnés (8 pts)
Epreuve de Santé Communautaire : Durée 02 Heures
Traiter le sujet suivant :
Dans une zone de responsabilité d’un poste de santé couvrant une population estimée à 17 500 habitants, il est noté des conditions sanitaires un peu déplorables.
Les membres de la communauté, dans l’ensemble analphabètes, croient à leur tradition : les enfants ne consomment pas de poissons, et certains aliments sont interdits aux femmes enceintes qui doivent en plus travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Durant un semestre, les pathologies recensées sont :
- Paludisme (125 cas dont 24 décès avec 4 femmes durant l’accouchement) ;
- Maladies infectieuse (56 cas dont 4 décès de mères allaitants depuis 01 mois) ;
- Anémie (35 cas dont 7 décès chez les femmes enceintes)
- Traumatisme (65 cas dont 9 décès constitués de femmes et d’hommes) ;
- Rougeole (25 cas) ;
- Tétanos (6 cas tous décédés ; 4 nourrissons ; 2 mères)
- Calculer le taux de mortalité générale ;
- Donner le taux de mortalité maternelle pour une natalité de 39 pour 1000 ;
- Identifier un problème prioritaire sur la base de trois (03) critères de sélection ;
Elaborer un plan d’actions permettant de résoudre ce problème
Sujet de Santé Communautaire : Durée 02 Heures
Vous venez d’être nommé responsable du programme Elargi de Vaccination (PEV) dans le poste de santé « FAGARU » dont 80% de la population habite à plus de 5 km du poste de santé. L’analyse des rapports d’activités des 6 derniers mois a permis de faire les constatations suivants : trente pourcent (30 %) de taux de couverture vaccinale, douze (12) cas de rougeole, cinq (5) cas de fièvre jaune, dix (10) cas tétanos néonatal dont huit (8) décès.
Par ailleurs, les informations ont été notées :
- Le taux de Couverture en Consultation Prénatal (CPN) est de 20% ;
- La population totale de la zone de responsabilité est de 13500 habitants ;
- Le nombre total de consultation par Consultation Primaire Curative (CPC) est de 3460 pour la période considérée.
- Calculer le taux de mortalité globale et le taux de létalité du tétanos néonatal pour la période.
Des investigations sur le faible taux de couverture vaccinale et de CPN ont permis d’identifier les facteurs ci-dessous :
- Pendant l’hivernage les villageois sont difficiles d’accès à cause des inondations, du mauvais état des routes et des moyens de transport insuffisants ;
- Quatre (4) séances de vaccination et de consultation prénatal sont organisées au poste de santé mais exclusivement en stratégie fixe ;
- Soixante-quinze pourcent (75%) des mamans ne connaissent pas le calendrier vaccinal du PEV ;
- Soixante-quinze pourcent (75%) des femmes ne fréquentent pas les services de CPN du fait de l’ignorance de l’utilité de la CPN ;
- Les activités d’IEC pour un changement de comportement rarement organisées à cause de la surcharge de travail de l’ICP et de l’absence de relais communautaires.
- Identifier les facteurs à l’origine du tétanos néonatal à « FAGARU ».
- Proposez un plan de résolution du faible taux de couverture vaccinale dans la zone de responsabilité du poste de santé de « FAGARU ».
Epreuve de Santé Communautaire : Durée 02 Heures
Infirmier nouvellement diplômé, vous êtes affecté à la région médicale de Dioloff. Le médecin chef région vous reçoit pour votre mutation dans une structure de santé et vous interpelle sur l’organisation du système national de santé, les Soins de Santé Primaire (SSP). Pour répondre à ses interpellations :
- Décrivez l’organisation du système national de santé au Sénégal en précisant le niveau d’intervention de l’infirmier chef de poste.
- Choisir parmi les principes suivants celui ou ceux non associés aux SSP :
- Accessibilité,
- Promotion de la santé,
- Collaboration multisectorielle,
- Egalité
- Technologie appropriée,
- Education pour la santé
- Citez cinq outils de gestion des médicaments essentiels.
Vous êtes muté au poste de santé de KEUR YABBA qui polarise les villages suivants :
| Villages
|
Nombres d’habitants | Distance du poste en km |
| YABBA | 3200 HBTS | 0 |
| FALLENE | 2200 HBTS | 7 |
| NDIAKHENE | 1200 HBTS | 10 |
| KEUR DIOR | 500 HBTS | 15 |
Les données nosologiques du mois de Juin 2016 montrent 287 patients en consultation primaire curative (CPC) pour les affections suivantes : paludisme ; diarrhées ; IRA ; parasitoses ; malnutrition et traumatismes. Vingt (20) malades étant revenus pour un suivi de leur traitement.
- Précisez le nombre de consultants et le nombre de consultations.
Les résultats du monitoring du premier semestre montrent un taux de couverture adéquate du PEV à 49% et de la CPN à 35%.
Les routes sont impraticables à certaines périodes de l’année, les moyens de transport sont rares, le poste dispose d’une moto tout terrain, mais les activités du postes sont privilégiées.
- Interprétez les taux de couverture adéquate du PEV et de la CPN.
- Proposez deux mesures correctrices pour améliorer la couverture du PEV et celle de la CPN du poste de santé de KEUR YABBA en donnant pour chacune :
-un objectif,
-deux activités,
La population cible pour chaque activité.
Epreuve de Santé Communautaire : Durée 02 Heures
Vous êtes infirmier diplômé d’ETAT en service au poste de santé de MBIR, crée en 2012 suite au nouveau découpage administratif.
La population du poste de santé était estimée à 16625 habitants avec un taux d’accroissement de 2,6%.
- Calculez la population de MBIR en 2016 suivant l’hypothèse de croissance exponentielle
Au bout de deux années d’exercices, vous vous rendez compte que les taux d’utilisation et de couverture en CPN et en PF sont très faibles malgré une bonne accessibilité des services et une disponibilité des médicaments.
Le dépouillement des registres de la maternité montre une fréquence :
- Des hémorragies de la délivrance,
- Des toxémies gravidiques tardives,
- Des associations de paludisme et grossesse,
- De femmes ayant un espace inter génésique inférieur à deux (2) ans,
- de multipares âgées de moins de 25 ans
Vous décidez de mener une enquête qualitative auprès de la communauté pour identifier les facteurs socioculturels à l’origine des problèmes de santé identifiés au niveau du poste.
- Indiquez la méthode de recueil de données la plus appropriée et justifiez votre réponse.
Il est ressorti de cette enquête que :
- La planification sociale n’est pas acceptée par les religions et qu’elle entraine une infécondité/infertilité,
- Faire la planification, c’est « abandonner des enfants dans son ventre »
- Les femmes ne fréquentent pas les services de CPN par peur du mauvais œil car pour elle « une grossesse, c’est comme la mayonnaise, quand on regarde, elle peut ne pas prendre »,
- Les femmes n’ont pas de pouvoir de décision.
L’analyse de cette situation a permis d’identifier les problèmes suivants :
- Un faible taux d’utilisation des services de CPN ;
- Un faible taux d’utilisation des services de PF.
- Proposez :
- Un objectif spécifique pour chaque problème,
- Deux activités pour chaque objectif spécifique en précisant la population ciblée
Pour mener des activités promotionnelles, vous envisagez de recycler les ASC sur la communication.
- Décrivez le processus de communication en précisant pour chaque élément les critères de qualité.
EXAMEN DE CERTIFICATION 2018/INFIRMIER D’ETAT SANTE COMMUNAUTAIRE
- Calculez la population de cette localité en 2020 selon l’approche exponentielle 3pts
population finale= pop initiale * er(f-i)
pop 2020= pop 2018 * e0.027(2020-2018)
Population 2020= 12500hbts
- Identifiez le problème prioritaire en se basant sur des critères pertinents
- CRITÈRES (5pts)
- Ampleur
- Vulnérabilité
- Population touchée
- PROBLÈMES 2pts
- 70% des jeunes n’ont pas effectué le dépistage 5pt
- 70% des femmes enceintes n’ont pas effectué de CPN 5pt
- 68% d’accouchement non assisté5pt
- 79% d’abandon de malades tuberculeux 5pt
- ECHELLE DE VALEUR (3pts)
- Ampleur 1 A 25% = 1 pt
26 à 50% = 2 pts
51 à 75% = 3 pts
76 à 100%= 4 pts
- Population touchée adulte = 1pt
Jeune = 2pts
Femme enceinte= 3pts
- vulnérabilité
La solution existe = 1 pt
La solution est acceptable= 1pt
La solution est applicable =1 pt
- tableau de priorisation (5pts)
| CRITERE
PROBLEME |
AMPLEUR | VULNERABILITE | POPULATION TOUCHEE | SCORE | RANG |
| DEPISTAGE AU VIH | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| COUVERTURE CPN | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| ACCOUCHEMENT NON ASSISTE | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| ABANDON TRAITEMENT DES TUBERCULEUX | 4 | 3 | 1 | 8 |
- Les facteurs à l’origine du probleme prioritaire (3pts)
- Couverture en CPN
- La plupart des femmes enceintes ignorent l’interet des CPN
- Les activités d’IEC/CCC ne sont pas menées au niveau du poste par surcharge de travail de l’ICP
- Les relais ne sont pas formés sur les techniques de communication
- ACCOUCHEMENT NON ASSISTE
- Les femmes enceintes préfèrent se rendre chez les accoucheurs traditionnels
- Les activités d’IEC/CCC ne sont pas menées au niveau du poste par surcharge de travail de l’ICP
- Les relais ne sont pas formés sur les techniques de communication
Proposez :
- Un objectif général + CRITERES (1pt)
- Deux objectifs spécifiques/objectif général + CRITERES (2pts)
- Deux activités /objectifs spécifiques + CRITERES (2pts)