Le commentaire composé est un exercice essentiel dans les concours administratifs et les examens du baccalauréat en France. Il vise à analyser en profondeur un texte littéraire afin d’en dégager le sens, les procédés stylistiques et les intentions de l’auteur. Ce cours détaillé vous guidera à travers les étapes clés de la réalisation d’un commentaire composé, illustrées par des exemples concrets pour faciliter la compréhension.
I. Compréhension du commentaire composé
Le commentaire composé consiste à analyser un texte littéraire en mettant en lumière sa structure, ses thèmes, ses procédés stylistiques et le message que l’auteur souhaite transmettre. Il ne s’agit pas de résumer le texte, mais d’en proposer une lecture analytique et critique.
II. Méthodologie du commentaire composé
Lecture attentive du texte
- Première lecture : Prenez connaissance du texte dans son ensemble pour en saisir les grandes lignes et les idées principales.
- Lectures suivantes : Identifiez les éléments clés tels que le genre, le registre, le thème, la structure, le style et les figures de style utilisées.
Analyse détaillée
- Contexte : Situez le texte dans l’œuvre de l’auteur, le mouvement littéraire et l’époque.
- Thème : Déterminez le sujet principal du texte.
- Registre : Identifiez le ton du texte (lyrique, tragique, comique, etc.).
- Structure : Observez la construction du texte (paragraphes, strophes, dialogues).
- Procédés stylistiques : Repérez les figures de style (métaphores, allitérations, etc.) et les choix linguistiques.
Élaboration de la problématique
- Formulez une question centrale qui guidera votre analyse, reflétant les enjeux du texte.
Construction du plan
- Organisez votre commentaire en deux ou trois parties principales, chacune subdivisée en sous-parties, pour répondre à la problématique.
Rédaction
- Introduction : Présentez le texte, situez-le, énoncez la problématique et annoncez le plan.
- Développement : Analysez le texte en suivant le plan établi, en reliant fond et forme.
- Conclusion : Résumez les points essentiels de votre analyse et proposez une ouverture.
III. Application pratique : exemple de commentaire composé
Appliquons cette méthodologie à un extrait de Véronique Le Goaziou, tiré de son ouvrage La violence des jeunes (2016) :
« Si la jeunesse a souvent alarmé les adultes, ce ne sont jamais tous les jeunes qui ont fomenté les plus vives inquiétudes, mais une petite partie d’entre eux. Ainsi, dans les pays européens au cours du XIXᵉ siècle, c’est l’« enfant des rues » ou l’enfant des classes populaires urbaines – et bien évidemment l’enfant délinquant – qui seront principalement visés. Et le formidable mouvement de protection de la jeunesse et de l’enfance qui s’érigera peu à peu cernera tout autant ce qui peut les menacer (l’enfance en danger) que ce qui peut les rendre menaçants (l’enfance dangereuse). Les appels à protéger la jeunesse sont indissociables des appels à éduquer les jeunes, mais aussi à les contrôler et parfois à les punir. Ce constant balancement entre l’enfant vulnérable qu’il faut accompagner et l’enfant malfaisant qu’il faut corriger perle encore de nos jours. »
Introduction
- Accroche : La perception de la jeunesse oscille souvent entre fascination et inquiétude, reflétant les tensions sociétales face aux comportements des jeunes générations.
- Présentation du texte : Cet extrait est tiré de La violence des jeunes de Véronique Le Goaziou, sociologue française spécialisée dans l’étude de la délinquance juvénile et des politiques publiques liées à la jeunesse.
- Résumé succinct : L’auteure analyse comment, historiquement, une minorité de jeunes issus des classes populaires urbaines a suscité l’inquiétude des adultes, conduisant à des politiques oscillant entre protection, éducation, contrôle et punition.
- Problématique : Comment la société a-t-elle construit et géré l’image d’une jeunesse à la fois vulnérable et potentiellement dangereuse ?
- Annonce du plan : Nous examinerons d’abord la construction historique de la figure de l’enfant dangereux, puis nous analyserons la dualité des politiques publiques oscillant entre protection et répression.
Développement
I. Construction historique de la figure de l’enfant dangereux
1. Identification d’une minorité inquiétante
- L’auteure souligne que ce n’est pas l’ensemble de la jeunesse qui inquiète, mais « une petite partie d’entre eux », notamment l’« enfant des rues » et l’enfant des classes populaires urbaines.
- Au XIXᵉ siècle, ces enfants étaient perçus comme des symboles de désordre social, incarnant les peurs liées à l’urbanisation rapide et à la pauvreté croissante.
2. Médiatisation et amplification des peurs
- Des figures comme les « Apaches » au début du XXᵉ siècle en France illustrent comment une minorité de jeunes délinquants a été médiatisée, amplifiant les peurs collectives et justifiant des mesures de contrôle accrues.
Transition : Cette construction sociale de l’enfant dangereux a conduit à des politiques publiques ambivalentes, oscillant entre protection et répression.
II. Dualité des politiques publiques : entre protection et répression
1. Protection et éducation
- Le « formidable mouvement de protection de la jeunesse » visait à protéger les enfants des dangers extérieurs (enfance en danger) et à les éduquer pour prévenir leur déviance.
- Des institutions comme les colonies pénitentiaires agricoles, telle celle de Mettray, ont été créées pour rééduquer les jeunes délinquants en les éloignant des influences urbaines néfastes.
2. Contrôle et punition
- Parallèlement, des mesures de contrôle et de répression ont été mises en place pour corriger l' »enfance dangereuse », reflétant la peur que ces jeunes inspirent.
- Ce « constant balancement » entre protection et punition est encore observable aujourd’hui dans les politiques publiques concernant la jeunesse.
Conclusion
- Résumé synthétique : Véronique Le Goaziou met en lumière la construction historique de la figure de l’enfant dangereux et l’ambivalence des réponses sociétales, oscillant entre protection bienveillante et répression punitive.
- Ouverture : Cette analyse invite à réfléchir sur les politiques actuelles de la jeunesse, notamment sur l’équilibre à trouver entre accompagnement éducatif et mesures coercitives, afin de répondre aux défis contemporains liés à la délinquance juvénile.
CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

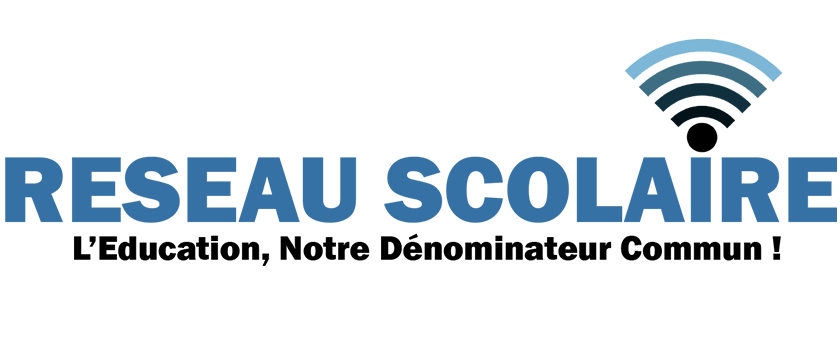











Is Cacao Bliss a scam or is it a legitimate product?: Cacao Bliss scam
Is NeuroPrime a Scam or Legit?: NeuroPrime scam