Consigne : Résumez le texte qui suit au quart de sa longueur initiale (soit 400 mots) avec une marge de tolérance de plus ou moins 10%.
Génocide et devoir d’imaginaire
Au cours des dix dernières années, le nom du Rwanda est devenu de plus en plus familier à un nombre croissant de nos contemporains, même à ceux qui n’ont jamais eu la moindre occasion de s’intéresser au continent africain. Ce n’est malheureusement pas par hasard, car pour réussir à susciter autant d’intérêt, ce pays à la fois minuscule et dépourvu de ressources naturelles a eu plus que sa part de souffrance.
La rapidité avec laquelle la communauté internationale a reconnu le génocide des Tutsis du Rwanda – sans rien tenter pour l’empêcher – n’a eu d’égale que la vitesse à laquelle celui-ci a été perpétré. Les massacres d’avril à juillet 1994 ont causé, selon l’ONU, la mort de 500 000 à 800 000 personnes. Les autorités rwandaises, qui n’ont pas fini de procéder au recensement des victimes, en estiment le nombre à plus d’un million, ce qui ne semble guère exagéré. Pour donner une idée de ce qui est arrivé au Rwanda, il suffit de dire que dix mille personnes y ont été tuées chaque jour, pendant trois mois et sans interruption.
Cette entreprise d’extermination n’a pas été déclenchée de façon subite et irraisonnée sous la pression de circonstances politiques imprévues. Elle a au contraire, été minutieusement préparée. Un État fortement centralisé a mis son armée, des forces paramilitaires créées à cet effet et toute son administration au service de l’élimination d’une partie de la population rwandaise choisie en fonction de son appartenance à une « ethnie ».
Très peu de commentateurs ont compris à l’époque la gravité des événements. Presque tous ont préféré voir dans ce génocide un nouveau cycle de « massacres interethniques » opposant, sur fond de « guerre civile » sans queue ni tête, deux communautés qui se haïssaient depuis des temps immémoriaux. L’utilisation répétée de ces expressions a convaincu le monde entier qu’il n’y avait ni bourreaux ni victimes en avril 1994 au Rwanda, que l’État rwandais, dépassé par les événements, faisant de son mieux pour ramener dans le pays l’ordre et la légalité, et enfin que ces atrocités tropicales anarchiques échappaient à toute analyse politique rationnelle. Cette dernière idée, qui explique en partie la passivité de la communauté internationale, était renforcée par l’image du continent dans les médias.
Il serait toutefois absurde de prétendre que la presse internationale s’était donné le mot pour faciliter la tâche aux tueurs. Elle n’avait aucune raison particulière d’en vouloir au Rwanda. La vérité est plus simple, mais peut-être aussi plus terrible : le Rwanda n’intéressait personne. S’il est établi que tel ou tel pays occidental lié au conflit a pu trouver, pour son travail de désinformation, des relais conscients parmi les envoyés spéciaux et les correspondants de presse, beaucoup parmi ces derniers ont surtout péché par désinvolture en n’écoutant que leurs préjugés. Dans une Afrique perçue comme le lieu naturel de tous les désastres, les massacres au Rwanda n’étaient qu’une tragédie de plus après – ou en même temps que – celles de Somalie, d’Algérie et du Libéria. Si on ne peut pas appeler cela du racisme, c’est que les mots n’ont plus aucun sens.
Dès lors, il n’est pas étonnant que le statut du génocide rwandais soit aujourd’hui encore, si singulier. Presque plus personne n’ose en contester l’aveuglante réalité. Cependant, dès qu’il s’agit d’en stigmatiser les auteurs, de sérieuses difficultés surgissent. Il est devenu habituel, on le sait, de personnifier les grandes infamies de l’histoire contemporaine, comme pour les ancrer à tout jamais dans les mémoires : Hitler et Pol Pot évoquent immédiatement les chambres à gaz et les champs de mort, en vertu du pouvoir de stigmatisation que sont arrogé les maîtres du monde. Le génocide rwandais, lui, n’est jamais nommé, car cela impliquerait un choix entre le Bien et le Mal. Dans ce cas précis, tout se passe comme si la compassion pour les victimes ne saurait aller jusqu’à reconnaître tout à fait leur innocence.
Cela dit, l’honnêteté oblige à ajouter que la tragédie rwandaise a suscité presque moins d’intérêt en Afrique même que dans le reste du monde.
Le paradoxe n’est qu’apparent. L’émiettement du continent africain en micro-États peu viables, maintes fois dénoncé par Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, ce traduit de nos jours par des situations inattendues. L’une de celles-ci est que l’Afrique est informée de ses propres problèmes politiques par les pays du Nord. Aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup d’Africains francophones n’ont su du génocide rwandais que ce qu’en rapportaient les dépêches de l’Agence France Presse, les grands de l’Hexagone et les journaux télévisés des messieurs Poivre d’Arvor et Masure. La presse privée africaine, embryonnaire à la fin des années 1980, n’avait pas les moyens de contrarier cette tendance. Elle n’était en mesure par exemple, par exemple, d’envoyer sur le terrain des journalistes porteurs d’une autre grille des événements. Mais, il n’est même pas certain que ces médias africains auraient échappé aux clichés sur le chaos africain. À force d’échecs, le continent en est venu à perdre tout respect de lui-même. Quoi qu’il arrive en Afrique, nos distingués analystes sur le continent seront les premiers à l’expliquer par notre prétendue incapacité à nous adapter au monde moderne si ce n’est, de manière encore plus affligeante, par on ne sait quelle antique malédiction.
Le résultat est que parmi les rares cris d’indignation entendus par le génocide, pas un seul ou presque n’est venu d’Afrique.
Nelson Mandela, fraîchement élu à la tête de l’Afrique du Sud post-apartheid, a été une heureuse exception. Dans le meilleur des cas, nous avons murmuré notre écœurement et notre honte.
Le plus souvent, nous avons fait preuve d’une indifférence quasi-totale.
C’est en réaction à ce « silence assourdissant » des intellectuels et artistes africains qu’est née l’initiative « Rwanda : écrire par devoir de mémoire ».
Tout a commencé en 1995, pendant la 5e édition de Fest’Africa. Le 10 novembre, la rencontre a été endeuillée par la condamnation à mort et la pendaison à Port-Harcourt de l’écrivain nigérian Ken Saro-Wiwa et de huit de ses compagnons. Les auteurs présents à Fest’Africa ont alors manifesté leur réprobation par une déclaration publique contre la dictature militaire de Sani Abacha.
Cela ne les a pas empêchés de constater, une fois de plus, l’impuissance des hommes de plume d’arrêter la main de chefs d’État criminels. Cet amer constat s’est mué, au fil des mois, en un besoin de plus en plus pressant de se faire entendre. Des discussions avec la communauté rwandaise de Paris ont mis en évidence la nécessité de s’intéresser de plus près au génocide de 1994. Il a alors été proposé à des auteurs de différents pays africains de se rendre au Rwanda en résidence d’écriture.
Les choses n’ont pas été aussi simples que nous l’avions cru. Il a fallu pas de trois ans pour convaincre les autorités rwandaises, d’abord réticentes, de nous laisser entrer dans leur pays. Il faut dire que la présence de francophones dans un projet soutenu par la Fondation de France n’était guère de nature à les rassurer. Ces réserves étaient bien compréhensibles, car François Mitterrand et les réseaux de la « Françafrique » s’étaient rangés sans état d’âme des organisateurs du génocide. Noky Djedanoum n’a pu faire fléchir ses interlocuteurs rwandais qu’en leur disant, sur un ton à la fois amical et sérieux : « Je revendique, en tant qu’Africain, le droit d’aller où je veux au Rwanda et vous, vous n’avez d’autre choix que de l’accepter. » Après les explications nécessaires, tout est rentré dans l’ordre (…).
Après la Shoah, beaucoup d’Allemand ont pu dire, avec toutes les apparences de la bonne foi, qu’ils ne savaient pas. Même ce mensonge n’était pas possible au Rwanda. Le génocide des Tutsis a eu ceci de particulier que l’État a réussi à y impliquer la majorité de la population. Il a eu lieu dans le bruit et la fureur, des centaines de milliers de cadavres pourrissaient sur les collines, une radio coordonnait joyeusement les massacres et partout les cris de haine se mêlaient aux cris de terreur.
La sérénité de l’historien peut-elle dire ce déchaînement des passions humaines les plus folles ? Je ne le crois pas. Le roman, qui trouve le tueur sur son terrain, celui de l’émotion et de la falsification, me paraît plus apte à remplir cette tâche. Il est encore le meilleur moyen de tirer de sa torpeur le brave homme qui, voyant que l’on charcute sans arrêt ses semblables autour de lui, lève les bras au ciel et dit d’un air sincèrement désolé qu’il n’y peut rien car ses journées sont bien trop courtes.
S’il est clair dans son esprit que lui n’a jamais voulu personne, il ne se rend pas forcément compte qu’il sert par son inertie mentale les desseins du fanatique prêt à exterminer des peuples entiers.
À ce brave père de famille vautré dans son salon, le roman peut presque parler au creux de l’oreille. Il peut aussi réveiller chez lui l’envie de redevenir un homme.
L’imaginaire est du reste d’autant plus autorisé à rendre compte d’un tel génocide que l’histoire récente du Rwanda résulte dans une large mesure d’un conflit entre la fiction et la réalité. Tout y est parti des fantasmes d’une certaine ethnologie coloniale qui a inventé, avec une déconcertante légèreté scientifique, une histoire non africaine à un pays africain./.
(Boubacar Boris Diop)
CORRECTION PROPOSEE
Le Rwanda, pays sans ressources naturelles, est devenu tristement célèbre en 1994 avec le génocide des Tutsis, causant entre 500 000 et un million de morts en seulement trois mois. Ce massacre, planifié et exécuté par un État centralisé, s’est déroulé sous le regard passif de la communauté internationale, pourtant informée dès le début.
De nombreux médias occidentaux ont réduit cette tragédie à un conflit ethnique dans un contexte de guerre civile, véhiculant ainsi une perception biaisée et raciste du drame. Cette vision stéréotypée de l’Afrique, perçue comme un continent voué au chaos, a favorisé l’inaction internationale. Même après la reconnaissance du génocide, ses auteurs n’ont jamais été désignés avec la même sévérité que d’autres criminels de masse comme Hitler ou Pol Pot.
L’Afrique elle-même n’a que peu réagi. L’absence d’une presse indépendante et la dépendance aux médias occidentaux ont empêché une prise de conscience réelle. Seule la voix de Nelson Mandela s’est élevée parmi les leaders du continent.
Face à ce silence, des écrivains africains ont lancé en 1995 l’initiative Rwanda : écrire par devoir de mémoire lors du Fest’Africa. Après trois ans de négociations avec un gouvernement rwandais méfiant, notamment vis-à-vis de la France, ces auteurs ont enfin pu témoigner de l’horreur vécue par les rescapés.
Le génocide a impliqué toute une population, rendant impossible l’ignorance. Dans ce contexte, la littérature apparaît comme un outil puissant de sensibilisation. En jouant sur les émotions et en déconstruisant les falsifications historiques issues de la colonisation, le roman permet d’éveiller les consciences et de lutter contre l’indifférence.
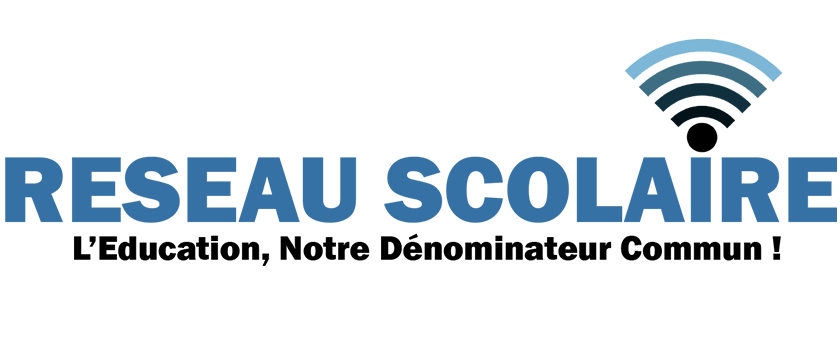

Is Dentavim a legitimate product, or is it just another overhyped supplement?: Dentavim scam
Is CARBOFIRE a scam, or is it a legitimate product?: carbofire scam
zudtex
Goodd post. I lewarn soething totaly neww and challenging oon bloogs I stumbleuon on a dwily basis.
It’s alwayys helpful tto read through articles feom other writers aand practice a ittle simething ffrom ther websites.