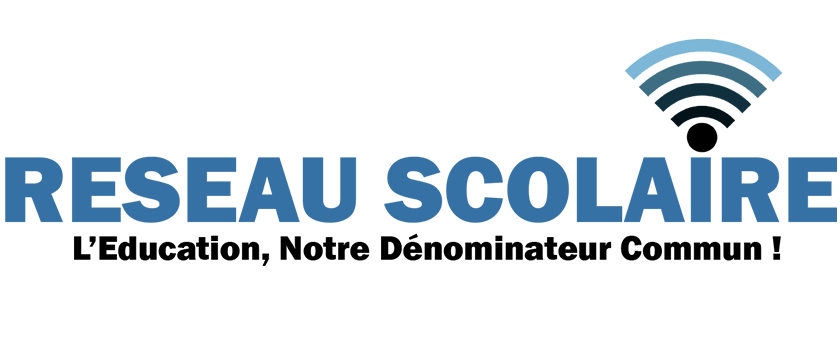LES SOINS AUX BRÛLÉS
OBJECTIFS
Décrire le rôle de l’infirmier(e) face à un brûlé sur les lieux de l’accident. Citer les paramètres sur lesquels se fonde la conduite à tenir (CAT) face à un brûlé. Déterminer les pourcentages, profondeurs et degrés de gravité d’une brûlure en se basant sur les lésions. Citer les risques encourus par un brûlé aux phases initiales et secondaires. Décrire les conduites à tenir face à un brûlé admis à l’hôpital.
I. PHYSIOPATHOLOGIE
1) À la phase initiale
Nous observons des désordres primaires caractérisés par une vasodilatation expliquée par l’augmentation de la perméabilité capillaire, aboutissant à un déséquilibre hydro-électrolytique, à la base du choc hypovolémique avec collapsus cardiovasculaire. Le brûlé est obnubilé et présente une oligo-anurie avec un risque de tubulopathie.
Ce choc est responsable de décès dans les 48 premières heures. Il est évitable par la réhydratation. S’il n’y a pas d’intervention pour rétablir l’équilibre par une réhydratation, il y a un retour des liquides vers le compartiment vasculaire avec risque d’œdème pulmonaire aigu (OAP).
2) À la phase secondaire
Trois (03) problèmes peuvent se poser : a) L’infection
- Aiguë, qui complique la brûlure vers la fin de la 1ère semaine.
- Subaiguë, après la 1ère semaine.
- Septicémique : cause de décès dans 50% des cas.
b) Problème nutritionnel On observe un déséquilibre métabolique avec hypo-protidémie et troubles hydro-électrolytiques.
c) Problème de cicatrisation Arrêt de la cicatrisation ou présence de chéloïde et/ou de brides.
II. EXAMEN DU BRÛLÉ
Son but est de faire le bilan pour poser les bases essentielles du pronostic.
- L’interrogatoire : il précisera les circonstances de survenue (heure, cause, vêtements portés, état général comme chez un diabétique ou un épileptique).
- Demander un papier sur lequel sera noté les premiers gestes entrepris (pansements, calmants administrés) ou autres médications entreprises (sérothérapie, antitétanique).
A. Le bilan local
Il permet d’apprécier trois (03) paramètres : l’étendue de la brûlure, sa profondeur et le siège.
- L’étendue Elle sera appréciée en se basant sur la règle des 9 de Wallace, la plus souvent utilisée, ou la table de Berkow.
a) Règle des 9 de Wallace
Site Adulte Enfant (1 à 15 ans) Tête et cou 9% 18% Membres supérieurs 9% x 2 9% x 2 Tronc 18% x 2 18% x 2 Périnée 1% 1% Membres inférieurs 18% x 2 13,5% x 2 b) La table de Berkow (voir polycope)
c) Règle de Gosseye
Si le pourcentage + l’âge est supérieur à 100, c’est un décès inévitable.
d) Classification selon l’étendue
Nature Étendue Légère Adulte < 15% Enfant < 10% Nourrisson < 5% Grave Adulte 15 à 30% et 2e degré, ≥ 10% et du 3e degré Enfant 10% Nourrisson 5% Très grave Pays en voie de développement 30 à 60% Pays industrialisés > 60% Mortelle Supérieur à 80% dans n’importe quel pays NB : Une brûlure est d’autant plus grave que le terrain est fragile : l’enfant, le vieillard, les sujets dénutris, ou lorsqu’elle est associée à un polytraumatisme (fractures multiples).
- La profondeur
- 1er degré :
- La brûlure est rouge et chaude comme un coup de soleil, la guérison est spontanée, seul l’épiderme est atteint.
- 2e degré :
- Superficiellement, l’épiderme plus ou moins une partie de la couche basale est atteinte, les vaisseaux et les nerfs sont à nu, d’où la présence de douleur.
- À l’effraction d’une phlyctène, on découvre un derme rose qui pâlit à la pression.
- Profondeur : les terminaisons nerveuses et les vaisseaux sont détruits, le derme est pâle, et il existe une hypoesthésie. La plaie guérit en cicatrisant sur les bords, et il y a un risque d’infection.
- 3e degré :
- On a une destruction de toute la peau, de la masse adipeuse, des muscles, des viscères et même des os peuvent être atteints. On a un aspect d’escarres cartonnées, il existe une anesthésie à la piqûre et au tact.
- La cicatrisation est difficile, on trouve en face des cicatrices rétractiles et fragiles. Comme traitement, on a la greffe de peau.
- 1er degré :
- Le siège Il constitue un élément de gravité :
- Voies respiratoires : le pronostic vital se pose avec l’obstruction des voies respiratoires.
- Le visage : on a un problème esthétique avec présence de chéloïdes le plus souvent.
- Articulations, mains et pieds : on peut avoir un enraidissement et des brides.
- Orifices (nez, vagin, anus, oreille) : on est confronté à une sténose cicatricielle.
B. Le bilan général
Il précisera l’âge, le niveau de conscience, l’état cardiovasculaire et respiratoire. Des comorbidités seront recherchées (diabète, insuffisance rénale, éthylisme, notion de grand fumeur). Les signes de choc seront également recherchés par rapport à l’hypovolémie. Un bilan biologique sera demandé avec des prélèvements pour : NFS, taux d’hématocrite, GSRH, ionogramme sanguin et urinaire, glycémie, protidémie.
III. LES SOINS D’URGENCE
A. Sur les lieux de l’accident
- Si ce n’est pas déjà fait : le brûlé sera retiré des lieux du sinistre, et s’il y a lieu, les vêtements enflammés seront éteints en emballant la victime dans une couverture non synthétique ou en passant un jet d’eau.
- Empêcher la victime de s’enfuir ou de se tenir debout lorsque les vêtements sont enflammés pour éviter l’activation de la combustion avec un risque d’aggravation des brûlures.
- Noter l’heure et examiner immédiatement le brûlé, évaluer sommairement l’étendue des lésions suivant la règle de Wallace sans les souiller.
- Si le brûlé est conscient, le rassurer ; dans le cas contraire, rassurer ses proches.
- L’emballer dans un drap propre pour éviter le refroidissement en attendant l’arrivée des secours, mettre la victime en position latérale de sécurité (PLS).
- Penser d’emblée au choc si la surface brûlée dépasse 5% chez le nourrisson, 10% chez l’enfant et 15% chez l’adulte.
- Se renseigner sur les causes et les circonstances de l’accident.
- Ne pas enlever les vêtements qui adhèrent à la peau, car il y a un risque de plasmorragie et d’infection.
- Ne pas vider les phlyctènes pour éviter la plasmorragie et l’infection.
- Ne pas enduire d’huile, d’œuf cru, de pâte dentifrice ou de la pommade pour éviter la surinfection des lésions.
- Devant des victimes multiples, évaluer les cas présents et évacuer rapidement les cas graves, en commençant si nécessaire l’assistance respiratoire.
B. À l’hôpital
- Dès l’arrivée du brûlé
- Le déshabiller, l’installer sur la table de consultation ou sur un lit et, si possible, sur champ stérile.
- S’assurer de la liberté des voies aériennes.
- Vérifier l’absence de détresse respiratoire. En cas de détresse, une intubation et une ventilation seront effectuées.
- Avertir le médecin réanimateur et le chirurgien.
- Dresser une feuille de surveillance de l’état général : pouls, tension, température, respiration, diurèse, état de conscience.
- Sur prescription médicale, administrer un calmant contre les douleurs (morphine chez l’adulte, valium chez l’enfant).
- Contre le choc :
- Placer une voie veineuse.
- Tonicardiaque (adrénaline ¼ mg) par voie veineuse.
- Corticoïdes (soludécadron) par voie veineuse (pour éviter l’anaphylaxie, contre les allergies).
- Oxygénation : si détresse respiratoire.
- Massage cardiaque externe : si détresse cardiovasculaire.
- Extrait de plasma : en cas d’hypovolémie.
- Faire Saturations Artérielle en Oxygène (SAT) et Volémie Artérielle Totale (VAT) si elles ne sont pas faites.
- Mesurer et peser le brûlé si possible, sinon estimer son poids.
- Préciser l’étendue et le degré des brûlures.
- Placer de manière aseptique, si nécessaire, une sonde vésicale à demeure.
- La dilatation aiguë de l’estomac étant fréquente chez les grands brûlés, placer une sonde gastrique.
- Au cas où la voie veineuse est obligatoire, s’il n’existe pas de plage de peau indemne, le chirurgien peut être appelé à faire une dénudation veineuse.
- Effectuer les examens biologiques initiaux
- Mettre en œuvre la réanimation liquidienne électrolytique
La formule d’Evans ou de Parkland peut être utilisée.
a) Selon la formule d’Evans
- Volume de liquide à perfuser pendant les 24 premières heures :
- Adulte = (2 x % x poids) + 2000 ml
- Enfant = (2 x % x poids) + 1000 à 1500 ml
- Composition des liquides à perfuser :
- Colloïde : sang ou extrait de plasma + dextran = 1 x % x poids.
- Électrolytes : sérum physiologique + Kcl + Mg2 + ou lactate de Ringer = 1 x % x poids.
- Ration quotidienne ou liquide de suppléance : Soluté Glucosé Isotonique (SGI) = 2000 ml chez l’adulte ou 1000 à 1500 ml chez l’enfant.
- Mode d’administration :
- Pour les 24 premières heures :
- La moitié des liquides sera perfusée durant les 8 premières heures.
- Le quart des liquides sera perfusé durant les 8 deuxièmes heures.
- Le dernier quart des liquides sera perfusé durant les 8 dernières heures.
- Pour le 2e jour :
- La quantité totale à perfuser sera égale à la quantité des 8 premières heures de la veille. Cette quantité de liquide sera divisée en 3 parties proportionnellement au 1er jour ; NB : si la quantité totale à perfuser dépasse 10 000 ml, par exemple : 12 000 pour le 1er jour, ne seront perfusés que 10 000 ml pour éviter un accident de surcharge. Les 2000 ml restants seront ajoutés à la quantité de liquide à perfuser durant le 2e jour.
- NB : au cas où la brûlure est du 2e degré et que le pourcentage dépasse 50%, le calcul sera uniquement basé sur les 50%, par exemple si la surface brûlée = 60% et que la brûlure est du 2e ou 3e degré, on aura pour la quantité totale à perfuser (2 x 50 x poids) + 2000 ml.
- Pour les 24 premières heures :